|
|
Afrique du sud/Miriam Makeba
Date de création: 09-12-2024 20:35
Dernière mise à jour: 09-12-2024 20:35
Lu: 344 fois
RELATIONS INTERNATIONALES- AFRIQUE DU SUD/MIRIAM MAKEBA
© MEHDI KAOUANE/EL moudjahid , 7 décembre 2024
En 1969, Alger, capitale de l’Algérie indépendante depuis seulement sept ans, devient le carrefour des luttes anticoloniales et des mouvements de libération. C’est dans ce contexte vibrant que Miriam Makeba, icône sud-africaine de la musique et militante contre l’apartheid, foule le sol algérien, marquant l’histoire culturelle et politique du pays. Miriam Makeba, surnommée «Mama Africa», est bien plus qu’une chanteuse : c’est une militante qui utilise sa musique comme un cri de révolte contre l’oppression raciale. En exil depuis 1960, elle trouve en Algérie une terre d’accueil, un lieu où résonnent des idéaux qu’elle partage : liberté, justice et solidarité entre les peuples opprimés. Alger est une plaque tournante pour les mouvements révolutionnaires du tiers-monde. Le gouvernement algérien soutient les luttes anticoloniales en Afrique, en Amérique latine et ailleurs. La présence de Makeba en 1969 s’inscrit dans cette dynamique. Invitée dans le cadre du premier Festival culturel panafricain d’Alger, elle incarne l’unité et la force du continent africain. Le Festival culturel panafricain d’Alger de 1969 est un événement majeur qui réunit des artistes, écrivains, musiciens et intellectuels de tout le continent africain et de la diaspora. Placé sous le signe de la renaissance culturelle africaine, il met en avant l’art comme outil de résistance et d’expression identitaire. Miriam Makeba, avec sa voix profonde et son charisme envoûtant, est l’une des figures centrales de cet événement. Ses performances, dont des classiques comme «Pata Pata» et «Malaika», transcendent les frontières linguistiques et culturelles, unifiant le public autour d’un message d’espoir et de résilience. Lors de son passage à Alger, Miriam Makeba tisse des liens avec d’autres figures de la résistance et de la culture. Dans la chanson «Ana horra fi El Djazaïr», je suis libre en Algérie, ce n'étaient pas des paroles vaines ou subliminales de sa part, elle qui, par la force de son art, avait été fortement impliquée dans le combat pour l'émancipation de l'Afrique. «Je suis libre en Algérie», interprétée en arabe, est un témoignage poignant de cette solidarité. En chantant ces mots, Makeba rend hommage à l'Algérie et à son peuple qui venaient de remporter leur liberté après une guerre d'indépendance sanglante contre la colonisation française. Sa rencontre avec les dirigeants algériens, notamment Houari Boumédiène, témoigne de l’importance de la solidarité entre l’Algérie et l’Afrique du Sud. À travers ses discours et ses chansons, Makeba rappelle que l’indépendance algérienne est une source d’inspiration pour d’autres pays encore sous le joug colonial. La présence de Miriam Makeba en 1969 reste gravée dans la mémoire collective des Algériens. Elle symbolise une époque où l’art et la culture servaient de ponts entre les luttes, unifiant les peuples dans leur quête de liberté. En célébrant l’héritage panafricain, elle a contribué à renforcer l’identité africaine et à souligner l’importance de la coopération entre nations libérées et celles toujours en lutte. Miriam Makeba à Alger en 1969 n’est pas seulement l’histoire d’une artiste se produisant dans une ville étrangère. C’est le récit d’un moment où la musique et la politique se sont croisées pour galvaniser un continent. Aujourd’hui encore, cet épisode rappelle la puissance de l’art comme vecteur de changement et de solidarité. Alger, en accueillant «Mama Africa», a réaffirmé sa place comme cœur battant des aspirations révolutionnaires du tiersmonde. Quant à Makeba, elle a laissé derrière elle un écho intemporel, celui d’une Afrique qui chante sa liberté avec fierté et passion.
|
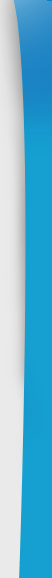 |